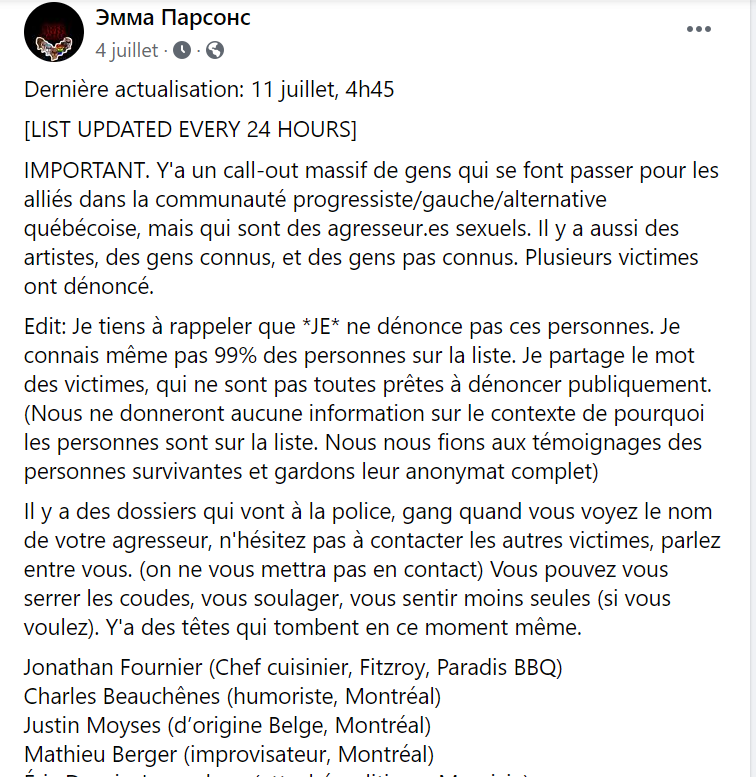« Mulierem fortem quis inveniet » (« Une femme forte, qui la trouvera ?», Proverbes 31, 10).
Camille Paglia n’a eu de cesse, au fil de ses livres, articles et conférences, d’analyser le féminisme de la seconde vague* comme un féminisme de bourgeoises de la classe moyenne supérieure enfermées dans des préoccupations extrêmement datées – à savoir la nécessité, bien compréhensible à l’époque, d’échapper à la vie monotone d’une maîtresse de maison des années 1950.
* Le féminisme de la seconde vague est né officiellement en 1966 aux États-Unis lors de la création par Betty Friedan de la NOW, National Organisation for Women. Le féminisme de la première vague, né en 1848 à la Convention de Seneca Falls dans l’État de New York, se concentrait pour sa part sur les droits de propriété et l’obtention du droit de vote des femmes (ratifié en 1920 aux États-Unis).
Leurs filles et petites-filles – les féministes d’aujourd’hui, donc – sont toujours curieusement recluses dans une boucle spatio-temporelle figée sur la fin des années 50 qui les pousse à s’envisager ad vitam comme de malheureuses housewives (appelées désormais « victimes du patriarcat ») se lamentant sans fin de ne pas vivre la vie rêvée des hommes. Alors que si elles faisaient l’effort de regarder le monde à travers leurs larmes de crocodile, elles s’apercevraient que leur situation est toujours statistiquement bien meilleure que celle des hommes : ces féministes, tout aussi aveugles à ce qu’elles doivent aux hommes, ressassent donc ad libitum des ressentiments hors d’âge. J’ai déjà eu l’occasion d’aborder cet anachronisme dans cet article :
À rebours de ces concerts de lamentations, ma toute première publication personnelle pouvait se lire comme un éloge de la femme forte – quand j’expliquais n’être pas intéressée par la complainte victimaire féministe, mais préférer prendre le pack complet de la libération de la femme, à savoir la liberté et les risques afférents – car l’un ne va jamais sans l’autre. Je n’ai jamais envisagé ma liberté (notamment sexuelle) au pays de Candy ou des petits poneys arc-en-ciel : j’ai toujours su que les hommes n’étaient pas des femmes, qu’ils auraient toujours des muscles plus puissants que les miens et que le mauvais contrôle de leurs pulsions pourrait me coûter ma vie. Je laisse les illusions d’indifférenciation sexuelle aux petites filles féministes qui confondent la vie réelle avec le monde molletonné des Bisounours – ou aux vieilles filles féministes qui ne se rêvent plus qu’en rééducatrices revêches et autoritaires (voir : [Féminisme punitif] – Valérie Rey-Robert, la control freak qui veut rééduquer les hommes).
En ces temps de grand-messe victimaire et de « culture du viol » servie ad nauseam, ce message semble plus que jamais incompréhensible et suscite toujours davantage de rejet que d’adhésion – tout au moins au sein de l’Église de la Pleurnicherie Perpétuelle ; ce pourquoi je le réitère :
Comme le dit très justement Samantha Geimer, autre figure féminine que j’admire : “Le problème quand on est une femme forte, une survivante, c’est que les militants ne peuvent rien tirer de vous. (…) Ils ont besoin de victimes, pas de rescapées. (…) Nous devrions au contraire servir d’exemples, donner du courage aux femmes qui se battent et les aider à se relever. Il n’est pas vrai que notre rétablissement nuise aux autres.”
À la lecture du recueil d’articles de Camille Paglia traduits en français par Gabriel Laverdière et publiés aux presses universitaires de Laval à l’automne dernier (Femmes libres, hommes libres. Sexe, genre, féminisme, 2019), je réalise à quel point je suis exactement sur la même ligne qu’elle, particulièrement lorsqu’elle dénonce les sempiternels comités des plaintes féministes :
« Le féminisme de deuxième vague s’est mis à privilégier les plaintes et préoccupations des femmes de carrière de la classe moyenne supérieure qui convoitent le statut enviable et les récompenses matérielles d’un système économique construit par et pour les hommes.
« Je postule que les femmes de la campagne étaient, et sont encore, plus fortes physiquement et mentalement que la plupart des femmes de carrière d’aujourd’hui, riches et accomplies, qui font obsessionnellement leurs exercices de Pilates dans de luxueux gymnases urbains ».
[Camille Paglia, Femmes libres, hommes libres, Laval (Qc), 2019, p. 318].
Et de déplorer que « la dorloteuse surprotection dont jouissent les filles dans les foyers bourgeois se prolonge dans les coûteux campus du Nord [des États-Unis] par l’ingérence paternaliste d’une classe d’administrateurs universitaires en croissance continuelle, qui se servent désormais de codes institutionnels de bonne conduite langagière pour forcer l’application d’une rectitude politique en ce qui concerne le sexe et le genre » (p. 319). Il s’agit là du féminisme paternaliste des campus universitaires que dénoncera à son tour Laura Kipnis dans Le Sexe polémique (2019).
Je me retrouve d’autant dans ces lignes que je me suis maintes fois fait la réflexion que mes origines bretonnes, la campagne bretonne d’où vient toute ma famille et où les femmes sont fortes – aussi fortes en gueule que dures à la tâche, avec un caractère trempé et une capacité innée à diriger leur maisonnée, hommes compris – pouvaient expliquer non seulement mon tempérament, mais mon mépris congénital pour le féminisme victimaire, cet incessant défilé de pleureuses sanglotant à gros bouillons sur tout et n’importe quoi, capables de tomber dans une « faille spatio-temporelle » parce qu’un homme, il y a 10 ans, leur aura dit qu’elles avaient de gros seins.
Non seulement ces simagrées ne m’inspirent pas la moindre compassion – elles n’en ont pas inspiré au juge non plus, ceci dit, puisque Sandra Muller, il faut le marteler, a été condamnée pour diffamation, mais, tout comme Paglia, elles me consternent.
« À mon avis », écrit-elle, « le problème avec le féminisme actuel est que, même quand il adopte des poses progressistes, il s’accorde trop souvent à un puant point de vue petit-bourgeois. Il invite l’ingérence et la protection de figures d’autorité paternalistes pour donner l’image d’une utopie hypothétique miraculeusement exempte de toute offense, de toute peine. La régulation fulgurante qu’il impose à la pensée et à l’expression est complètement réactionnaire, une grossière trahison des principes radicaux de la contre-culture des années 1960 ».
« Les notions presque victoriennes promulguées par les féministes d’aujourd’hui sur la fragilité des femmes et leur naïve inaptitude à maîtriser leur propre vie amoureuse me consternent et me stupéfient encore et encore ».
« L’impensable tournant régressif du féminisme actuel vers la censure est par conséquent épouvantable et tragique ».
[Camille Paglia, Femmes libres, hommes libres, Laval (Qc), 2019, p. 354-356].
Pour sa part, Camille Paglia renvoie à ses origines italiennes et aux femmes de sa famille, des paysannes puissantes qui régnaient sans partage sur leur univers – et au-delà. La même chose pourrait se dire de la persona, comme elle dit, c’est-à-dire du type de la « montagnarde des Appalaches », voire même de tous les modèles féminins de la « femme vieillissante » des cultures agraires et ce, qu’elles que soient la latitude et la période envisagées – puisqu’il s’agissait du mode de vie de la totalité des sociétés d’avant le XXe siècle. Mais les féministes, étant nulles en anthropologie et ne sachant rien faire d’autre qu’analyser le capitalisme avec leurs petites lunettes marxistes, sont bien incapables de s’en rendre compte : la réalité devant laquelle elles sont aveugles, c’est que la femme peut très bien être puissante sous le « patriarcat », et d’ailleurs, elle l’était !
À l’échelle de la longue durée, cette complainte féministe m’est donc toujours apparue, à moi aussi, comme un phénomène hyper-contemporain se rapportant exclusivement à nos sociétés post-industrielles et pacifiées (par le sacrifice de millions de jeunes hommes sur les champs de bataille, ne l’oublions jamais), et où des générations de citadines de plus en plus fragiles émotionnellement se succèdent, adhérant à un féminisme de plus en plus régressif, infantilisant et punitif.
La complainte larmoyante de la petite bourgeoise citadine et misandre m’apparaît finalement comme un épiphénomène et le modèle de la pleurnicheuse du genre promu par le féminisme universitaire une vaste mascarade vouée à se dissoudre dans sa propre vacuité. Je suppute, comme Camille Paglia, que le féminisme des études de genre ne produira au final que des milliers de pages qui serviront au mieux à caler les armoires dans quelques décennies :
« Pour chaque livre féministe convenable, il en paraît une vingtaine d’autres qui sont truffés d’inexactitudes, de déformations des faits et de propagande. Et de cette production surabondante, n’a émergé aucun ouvrage majeur : un seul livre féministe moderne s’est taillé une place de choix dans l’histoire des idées : Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui a plus de 40 ans » (p. 150). De plus, « l’institutionnalisation des études féministes et ses effets sur le féminisme n’ont encore fait l’objet d’aucune étude honnête » (p. 243).
En réalité, ce féminisme victimaire ne sert plus qu’à alimenter le désœuvrement et la paresse intellectuelle de gauchistes en débine, comme les dernières recrues d’Europe Ecologie-Les Verts nous en offrent actuellement l’affligeante démonstration. En espérant que ces miasmes soient vite balayés – même si cela prendra du temps, car la bêtise se répand toujours plus vite que la raison –, je ne doute pas un instant que ces délires finiront dans les poubelles de l’histoire et de la pensée.
- Camille PAGLIA, Femmes libres, hommes libres. Sexe, genre, féminisme, Laval (Qc), P.U.L. (trad. Gabriel Laverdière), octobre 2019.
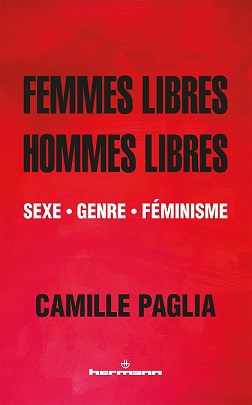
- Au Québec, Denise Bombardier est sur une ligne similaire et cela fait bien plaisir de voir qu’un autre discours commence à être porté par les femmes elles-mêmes. Car le victimisme met en réalité les femmes en danger : Denise Bombardier, « La longue plainte des filles », (Journal de Montréal, 04/08/20)
[Illustration de couverture : Tarot Visconti-Sforza, XVe siècle (La Force)]
- Sur les antiféministes bretonnes avec du tempérament, voir aussi :
- Sur Camille Paglia, voir aussi :