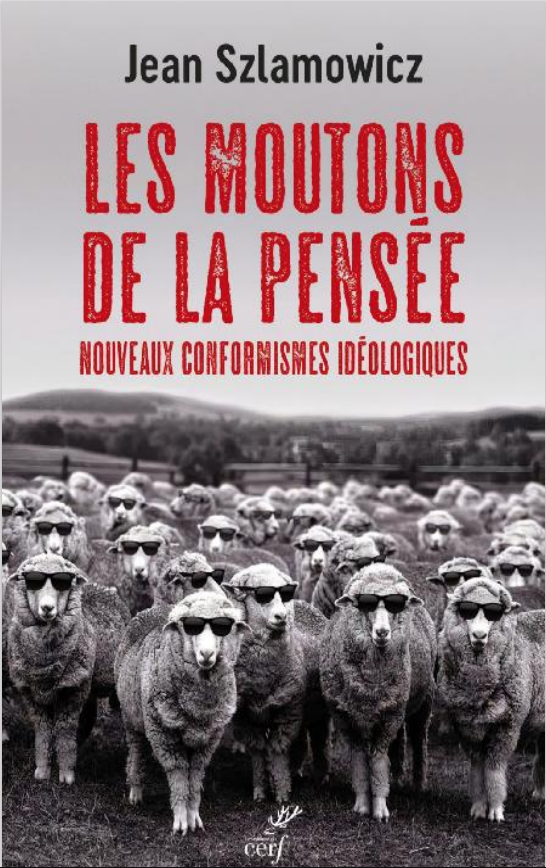L’affaire Amber Heard / Johnny Depp fait trembler les idées reçues en la matière puisque le procès entre eux tend à révéler qu’elle était plutôt, elle, coupable de violences. L’occasion de rappeler que les études menées par les sociologues et criminologues montrent systématiquement que les femmes dans les relations hétérosexuelles ont tendance à commettre des actes de violence contre leurs partenaires intimes au moins aussi souvent que les hommes.
Avec Ero Makia, Sabine Prokhoris
Atlantico : Alors que les débats du procès en diffamation opposant Johnny Depp et Amber Heard se terminent ce vendredi 27 mai, il ressort que Amber Heard serait au moins tout aussi coupable de violences conjugales. Alors que de nombreuses études ont démontré que les femmes peuvent se rendre coupables de telles violences , parfois plus que les hommes, comment expliquer l’idée reçue qui avance le contraire ? Que savons-nous des chiffres concernant les violences masculines ou féminines ?
Ero Makia : Les statistiques nous apprennent en effet que les femmes commettent davantage d’agressions conjugales que les hommes. Bien entendu, il s’agit essentiellement de violences psychologiques, verbales ou physiques, mais non létales – donc moins graves. Ceci ne doit pas faire oublier cependant que si les femmes ne tuent pas directement (ou rarement), elles peuvent tuer indirectement. Les taux de suicides masculins suite à des violences conjugales (VC) sont significatifs (Davis, 2010). Les femmes pratiquent également davantage d’infanticides, notamment dans la première année – la question de certaines morts subites du nourrisson (sans parler de celles des « bébés secoués ») a même été soulevée – et elles sont également fortement impliquées dans les violences aux personnes âgées dont elles ont la charge, à domicile comme en institution. Les violences familiales, à commencer par la maltraitance infantile, sont également le fait des deux sexes à égalité (par ex. en 2002, 48% des parents maltraitants étaient les mères ; cf. Élisabeth Badinter, « La vérité sur les violences conjugales », L’Express , 20/06/2005).
La violence féminine, une réalité anthropologique trop souvent mise sous le boisseau par les féministes, s’exercerait notamment lorsque les femmes sont en position de domination, physique ou psychique, à l’égard des enfants, des personnages âgées, de leurs conjoints… Cette violence féminine s’observe également dans les couples lesbiens – ce qui démontre en soi que le « patriarcat » n’est pas en cause. Chez les couples de même sexe, les études montrent d’ailleurs que, toutes violences confondues, l’incidence de violences conjugales est exactement la même que chez les couples hétérosexuels (1 couple sur 4 en 1998 selon une étude canadienne, cf. Badinter, 2005). Parmi les explications apportées à l’actuelle augmentation de la violence chez les femmes, Élisabeth Badinter propose d’y voir une traduction de la montée de l’égalité et du pouvoir : plus les pouvoirs sont partagés et plus on serait violent. On ne devrait plus dans ce cas parler de « violence de genre », mais de « droit du plus fort ».
L’affaire Depp/ Heard met en lumière les violences réciproques dans le couple – peut-être ici, exclusivement féminines, le verdict nous le dira. De nombreuses études ont depuis longtemps fait ressortir que la majorité des VC (57,9 %, selon des données rappelées par Laurent Puech) sont de la même manière « bi-directionnelles », c’est-à-dire en provenance des deux partenaires. [MàJ : voir par exemple le cas d’Aya Nakamura qui a déclenché le conflit avec son ex-conjoint avec une scène de jalousie puis l’a frappé avec une bouteille : « Violences conjugales réciproques : peines d’amendes requises contre Aya Nakamura et son ex-conjoint » (BFMTV, 26/01/23]
En 2006 déjà, plus de 150 études dans le monde faisaient ressortir une « symétrie de genre » dans les VC, les femmes apparaissant comme étant aussi violentes que les hommes : « Plus on élargit la définition de la violence pour inclure le harcèlement et les violences psychologiques, plus la part des femmes violentes augmente, pour atteindre la majorité des faits les moins graves – c’est-à-dire les plus nombreux », écrit ainsi François Bonnet (« Violences conjugales, genre et criminalisation : synthèse des débats américains », Revue française de sociologie, 2015). Parler de « violence genrée » ou de « violence sexiste » n’a désormais tellement plus de sens que certains chercheurs en sont même arrivés à considérer que « la question de la violence est secondaire dans l’étude des violences conjugales » ! (Bonnet, §47). Le fait que les femmes soient aussi fortement impliquées explique certainement cela.
Dans des études de 2006 et 2010, il apparaît également que les femmes sont autant les initiatrices des coups que les hommes (Bonnet, §11). Pour autant, plus de 70% des homicides conjugaux restent commis par des hommes (§12) – et 30% par des femmes. La violence masculine létale reste donc un fait incontestable (mais sans que cela implique pour autant que le « patriarcat » ait quelque chose à voir).
Rappelons au passage que les homicides conjugaux, notamment les uxoricides (le meurtre de son épouse ou de sa compagne – parce qu’elle est sa compagne et non pas n’importe quelle femme), ont baissé régulièrement entre 2007 et 2017, passant de 166 à 109 (cf. Laurent Puech, « Morts violentes au sein du couple : derrière les discours alarmistes, une baisse de 25% depuis 2006 », Délinquance, justice et autres questions de société, 27 février 2019) ; une baisse plus importante encore si l’on tient compte de l’augmentation de la population dans la même période, ce qui conduit à une baisse de 25 % en 10 ans ; une donnée factuelle qui n’est jamais reprise comme telle car n’allant pas dans le sens du narratif féministe. Peu de choses également nous sont dites sur les profils culturels exacts des mis en cause, tout au moins quand ils ne correspondent pas au profil de l’occidental blanc – mais passons. Les cas « d’euthanasie » compassionnelle chez les couples âgés ne sont pas non plus distingués dans les comptages d’uxoricides ; pour autant ils n’ont manifestement pas grand-chose à voir avec un « patriarcat systémique ».
Concernant la « bi-directionnalité » des violences conjugales, des données nous sont rapportées pour la France dans une enquête BVA/L’Express (juin 2005) qui donnait exceptionnellement la parole aux hommes. On y découvrait qu’ils se plaignaient davantage de la jalousie de leur partenaire, de ses questions intrusives (« Où es-tu, avec qui ? ») ou de ses dépenses sans leur consentement. Les femmes se montraient également plus critiques sur le physique et plus insultantes : 15% des hommes se disaient injuriés contre 8% des femmes. Quasiment le double, donc. Pour ce qui est des violences non létales, il y a donc bien un double standard qui perdure dans le discours public, et qui amène à être surpris devant les violences d’Amber Heard, en réalité bien plus courantes qu’on ne pense – à quelques détails près tout de même, comme les excréments sur le lit (du moins on l’espère).
Il convient ensuite de distinguer entre les formes de violences conjugales et de rejeter le « continuum » féministe misandre. Les féministes amalgament en effet toutes les formes de VC, n’évoquant qu’une « différence de degré » entre une plaisanterie graveleuse et un homicide conjugal, alors que la différence est bien de nature. Cette pratique de l’amalgame a pour avantage d’être plus percutant et de porter plus loin la victimisation des femmes (toutes) et la criminalisation des hommes (tous).
Il convient ainsi de distinguer entre les coups portés par les mots et ceux portés par les poings. Selon l’Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France (ENVEFF) de 2001, dans 75% des cas, la VC n’est pas constituée par de la violence physique mais exclusivement de la violence psychologique. Ensuite, à l’intérieur des VC, les chercheurs distinguent entre la « violence situationnelle de couple » (les inévitables et fréquentes disputes de la vie quotidienne qui peuvent dégénérer – sans que le « patriarcat » n’ait toujours rien à voir avec cela) et les comportements hautement toxiques tels que le « terrorisme conjugal », une dynamique de couple nettement plus rare « où l’un des partenaires porte atteinte à l’intégrité et à la dignité de l’autre par un comportement agressif, actif et répété dont le but est de le contrôler ». Cette seconde forme de violence est davantage le fait des hommes, mais le recueil des témoignages est biaisé par le fait qu’il se fait essentiellement auprès des foyers de femmes battues, où les violences sont les plus graves (Bonnet, §26).
Sabine Prokhoris : Sur les chiffres, je ne m’avancerais pas, ce n’est pas mon champ de compétence. Je vous renvoie à des travaux de sociologie informés, évoqués notamment par le sociologue François Bonnet. Mais je ne prendrai certainement pas pour argent comptant ceux fournis par les associations militantes, établis sans méthodologie sérieuse, et biaisés par des présupposés idéologiques de nature à obscurcir plutôt qu’à éclairer l’appréhension de situations qui relèvent de la sphère intime.
Ensuite, le terme de « violences conjugales » est bien trop général. De quoi parle-t-on exactement ? Des coups et blessures volontaires – cela arrive bien sûr, rarement – et crimes conjugaux, qui relèvent du champ pénal ? Des disputes furieuses qui éclatent au sein d’un couple, chacun faisant monter la scène de ménage en puissance sans que les femmes ne soient en reste ? Des dynamiques de harcèlement, humiliations, pressions de toute sorte, y compris sexuelles, et abus psychologiques variés qui peuvent s’installer dans un couple ?
Le discours martelé aujourd’hui affirme – sans démonstration probante, ni souci de la réalité précise de situations distinctes – le « continuum » de la violence « patriarcale »/sexiste/sexuelle envers les femmes (et les enfants). Or l’expérience ordinaire, et la clinique psychanalytique, montrent que la conflictualité dans une relation de couple – cela tout autant d’ailleurs au sein des couples gays ou lesbiens –, qui peut dégénérer en destructivité ravageuse, procède non du genre/sexe des partenaires du couple, mais de la dynamique de la relation telle qu’elle s’est nouée entre deux personnes.
Et comme l’écrit la romancière américaine Nancy Crampton Brophy, auteure d’un essai intitulé Comment tuer son mari – et qui vient d’être reconnue coupable du meurtre de son conjoint –, « la chose à savoir avec le meurtre, c’est que chacun en est capable si on le pousse suffisamment. » Sans en arriver à ces extrémités « l’effort pour rendre l’autre fou », à coup d’injonctions contradictoires et autres comportements persécuteurs, est une tentation dont nul, homme ou femme, ne peut se croire à l’abri.
Le patriarcat est souvent mis en avant pour expliquer les violences conjugales. Alors que la vérité semble moins genrée qu’il n’y paraît, comment expliquer que l’argument politique du patriarcat et de la domination masculine soit à ce point là mis en avant comme facteur explicatif ?
Ero Makia : Le narratif sur le « patriarcat », utilisé pour expliquer les VC, ressortit exclusivement à des montages idéologiques féministes. Le « patriarcat », un concept qui ne s’est répandu dans les études universitaires qu’à partir des années 1980, n’était au départ qu’un postulat du féminisme radical américain inspiré par la sociologie bourdieusienne sur la « domination masculine ». Pour ma part, c’est dans les écrits des théologiennes protestantes américaines, qui l’utilisaient pour féminiser le divin, que je l’ai vu apparaître pour la première fois. Sa radicale simplicité (des gentilles versus des méchants) a ensuite fait son succès planétaire. Mais que des milliers de militantes tout juste sorties de l’école défilent dans les rues en dénonçant sur leurs pancartes « l’hétéropatriarcat » et autres billevesées n’en fait pas un fait historique ou anthropologique avéré, pas plus que les piles de discours féministes qui le mettent à toutes les sauces. Car ce « patriarcat » ne serait rien d’autre, si l’on y regarde de plus près, que la marque d’infâmie que les féministes ont eu l’idée d’accoler à l’intégralité de l’histoire et de la civilisation occidentales pour pouvoir mieux les dénigrer.
L’idée reçue comme quoi les hommes seraient entièrement comptables des VC n’est due qu’à ce militantisme féministe. Il s’agit de discours qui, depuis les années 1980, répètent que les sexes se répartissent en deux groupes : la classe des oppresseurs, des bourreaux, des assassins, des violeurs et des coupables (les hommes) et la classe des simples victimes (les femmes). Le paradigme de la domination masculine et du patriarcat n’a donc pas pour objectif de condamner uniquement les hommes violents (ce qui serait légitime) mais la gent masculine dans son ensemble (ce qui est inacceptable et contraire à toutes les valeurs de l’humanisme).
Sabine Prokhoris : Comme toutes les explications générales, particulièrement lorsqu’elles sont idéologiques et opèrent comme des croyances, elle est inutile et incertaine. Car tel qu’il est employé dans le discours militant (souvenons-nous d’Alice Coffin déclarant urbi et orbi que « ne pas avoir un mari, ça m’expose à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée » – on goûtera au passage la formule en l’occurrence curieuse « ça m’expose »), le terme « patriarcat » n’explique rien.
Non qu’on ne puisse parler de sociétés ou de pratiques « patriarcales », bien entendu. Lorsque le statut des femmes est institutionnellement subalterne – voir les sociétés où le droit personnel est organisé par la charia –, ou que les conservatismes religieux, dans des sociétés modernes, prétendent contrôler le corps des femmes, comme on le voit dans nombre de pays sur la question de l’IVG, en Amérique latine par exemple, ou des jeunes filles se retrouvent en prison pour avoir fait une fausse couche, et ces temps-ci aux États-Unis, bien sûr qu’il est pertinent de parler d’oppression patriarcale. Mais évoquer une entité telle que LE « patriarcat » source « systémique » de tous les maux de la société, ça sert plutôt à galvaniser un activisme dénué de discernement qu’à penser de façon pertinente la réalité concrète en ses complexités.
J’ajoute que dans le discours militant contemporain, on parlera plutôt de « l’hétéropatriarcat blanc colonial », ce qui conduit à quelques impasses du point de vue féministe. Ce discours infiltre même des institutions telles que le Planning familial, qui vous explique doctement que le genre est « une classe sociale » (?) et qu’« en Occident [sic] elle comporte deux catégories : les hommes qui sont les dominants, et les femmes qui sont les dominées ». Comme le monde est simple…
Comment en sommes-nous arrivés à ces représentations ?
Sabine Prokhoris : Divers facteurs peuvent expliquer cela. Impossible d’entrer dans le détail. Je mentionnerai simplement l’hégémonie grandissante, depuis #MeToo, d’une doxa militante hors sol, biberonnée aux slogans d’activistes de la mouvance de Caroline de Haas et de quelques autres, et hypnotisée par les « théories » fumeuses, et disons-le dangereuses, de la psychiatre militante Muriel Salmona, « spécialiste » autoproclamée en « victimologie traumatique ». Ces activistes ont aujourd’hui l’oreille des pouvoirs publics, pénètrent au cœur des institutions de l’État, et diffusent leur idéologie simpliste et falsificatrice dans l’opinion publique, avec le concours de la plupart des grands médias, tout sens critique jeté par-dessus bord.
Ero Makia : Par le matraquage du féminisme idéologique qui tient notamment l’université et les médias. Il est quasiment impossible aujourd’hui d’échapper à sa propagande victimaire, dans quelque pays développé que ce soit. Également parce qu’on néglige d’interroger les hommes dans les enquêtes sur les violences conjugales et que dans le même temps, on se garde de demander aux femmes de rapporter leur propre violence (on ne leur pose que des « questions de victimation ») : « Ce choix a pour conséquence de faire disparaître la symétrie de genre par non-recueil des données » (Bonnet, §33). De plus, les enquêtes sur les VC ne sont en général faites qu’auprès des femmes victimes de violence recrutées dans les refuges, qui ne sont pas représentatives de la réalité et de la complexité des conflits dans les couples. On sait pourtant qu’en 2003 déjà, un homme mourait tous les 16 jours sous les coups de son épouse et tous les 14 jours en 2006 (cf. « Quand le sexe faible cogne fort », Ouest-France, 7/06/2007). On sait aussi que les hommes sous-déclarent les violences dont ils sont victimes, quand les femmes les surestiment (dans les conflits de divorce et de garde d’enfants en particulier).
Paradoxalement, le déballage assez trash du procès Johnny Depp/Amber Heard est en train de faire naître l’espoir que les violences féminines, « bi-directionnelles » ou « interactives » (la majorité), soient enfin reconnues et que la parole des hommes se libère à son tour. Si Johnny Depp a pu avoir affaire à un cas particulièrement coriace de manipulatrice (la psychologue du camp Depp ayant qualifié Heard de personnalité borderline et histrionique, froide, peu empathique et théâtralisante), la majorité des hommes victimes de leur conjointe le sont dans un contexte de « violence situationnelle » plus classique, mais où les violences réciproques peuvent être liées de la même manière à une lutte pour le pouvoir entre les deux conjoints (cf. L. Puech). Que cette mésaventure soit arrivée à une star comme Johnny Depp pourrait encourager d’autres hommes à surmonter leur honte pour en parler.
En accusant le patriarcat d’être le facteur principal des violences faites aux femmes, délaisse-t-on les racines du problème, c’est à dire notamment le profil psychologique des auteurs de violences qu’ils soient hommes ou femmes ?
Ero Makia : Oui, tout à fait ! Les violences conjugales révèlent souvent des couples dysfonctionnels ou pathologiques, et pas seulement les tares du fauteur de troubles, même quand la violence est unidirectionnelle. Du fait de la focalisation sur la « domination masculine », les arcanes de la psychologie ne sont pas suffisamment pris en considération, ce qui empêche d’apporter des solutions à l’un, à l’autre ou aux deux protagonistes, et ceci finit par être préjudiciable aux femmes elles-mêmes – puisqu’en général, ce sont elles qui se retrouvent en situation d’infériorité musculaire et physique si le conflit dégénère. Laurent Puech rappelle pourtant qu’une thérapie de couple « peut s’avérer pertinente et mener à des résultats notables ». Pourtant, écrit-il, « la thérapie de couple reste dramatiquement peu développée et professionnalisée en France ». Ce qui n’empêche pas, bien sûr, de développer et d’appliquer des mesures de protection lorsque la violence est unidirectionnelle (42 % des cas).
La psychologie des personnes violentes, particulièrement quand il s’agit des hommes, n’est pas suffisamment prise en compte. Les féministes des réseaux sociaux renvoient toujours tout homme avec qui elles ont eu maille à partir, de la moindre chamaillerie au harcèlement le plus lourd, à la catégorie fourre-tout du « pervers narcissique à abattre », la nouvelle panoplie dont elles affublent tout homme leur ayant fait l’affront de leur résister. Elles n’affichent souvent que mépris pour les souffrances des hommes – parce qu’ils sont des hommes. Pourtant, pour les psychologues, les types de personnalité seraient bien des facteurs explicatifs des VC. On sait notamment que les personnalités, « impulsives », « antisociales » et « psychopathes » seraient 13 fois plus violentes que les autres : « Parmi les prédicteurs non strictement sociaux des violences conjugales, il y a le fait d’avoir été auteur ou victime de violences, la faible estime de soi, la séparation récente, ou le fait que l’usage de la violence soit normal et habituel dans une société donnée » (Bonnet, §8).
Peggy Sastre démontre pour sa part dans La Domination masculine n’existe pas (2015), que la jalousie et la suspicion d’infidélité sont relevées dans 80% des cas de VC (p. 93). Elle rappelle aussi que la jalousie touche à égalité les deux sexes mais qu’il existe une dangerosité propre à la jalousie masculine car celle-ci est un catalyseur spécifique de violence domestique, ce que confirment nombre d’études (p. 86). Les études montrent aussi que l’âge de la femme joue un rôle : les violences conjugales ont tendance à baisser à mesure que la femme approche de la ménopause et du tournant des 45 ans : les femmes en âge de procréer en sont statistiquement 10 fois plus victimes. Il s’agirait donc possiblement d’une stratégie inconsciente pour « contrôler la capacité reproductive de la femme ». Une explication évolutionnaire (et en rien une justification des VC) qui reste cependant rejetée par les féministes idéologiques car n’allant pas dans le sens de leur agenda.
Si la jalousie, la frustration, la colère ou l’insécurité affective peuvent déclencher des comportements impulsifs poussant certains, surtout des hommes, à commettre l’irréparable, tous ne passeront pas à l’acte car, contrairement, à ce que sous-entendent les féministes, tous les hommes ne sont pas par essence (ou du fait de la « domination masculine »), programmés pour être des criminels. Parmi les pistes récentes à prendre en compte pour prédire avec efficacité la survenue de VC, il y a celle de la « théorie de l’attachement » (Limor Gottlieb, « Domestic Violence Is Not the Result of Patriarchy », Quillette, 21/05/22).
La théorie de l’attachement postule que la qualité de nos relations et de notre sécurisation affective durant notre petite enfance peut influencer nos modes d’attachement à l’âge adulte. Ceux-ci peuvent être sécures ou insécures et, parmi ces derniers, anxieux ou évitants. Les profils anxieux sont les dépendants affectifs, ces « abandonniques » qui craignent plus que tout de devoir revivre un rejet ou un abandon (que pourtant ils vont souvent provoquer) ; quant aux évitants, ils sont effrayés par l’intimité et se montrent distants et fuyants. C’est surtout chez les anxieux que l’on risque de trouver les personnes les plus violentes, hyper-contrôlantes ou harcelantes. L’un des principaux facteurs prédictifs des VC est, comme on peut l’imaginer, l’appariement entre un partenaire anxieux et un évitant, le premier mettant une pression considérable au second, qui prend la fuite… L’anxieux peut être aussi bien un homme qu’une femme ; la femme se montrant possessive, collante et invasive et l’homme recourant facilement au harcèlement voire à la violence en cas de rupture (qu’il vit très douloureusement), allant jusqu’à traquer son ex-partenaire ou cherchant à se venger. Rappelons que les femmes peuvent également pratiquer le stalking (le fait de « suivre, traquer et harceler de manière obsessionnelle une personne contre sa volonté »). Un travail sur soi
avec l’aide d’un professionnel peut cependant améliorer la situation, c’est pourquoi il faudrait davantage développer cette approche pour éviter la survenue de drames.
Sabine Prokhoris : Comme je le signalais plus haut, le biais « violences faites aux femmes » perd de vue que les « violences » et abus existent tout autant dans les couples de même sexe – lesquels sont moins nombreux il est vrai. Dans un couple hétérosexuel (mais pas seulement !), la dispute, et les insultes vont bien sûr facilement puiser dans le vaste répertoire des humiliations « genrées » (sexistes). Cela est vrai de l’homme qui traite sa compagne de « grosse pute nulle », de « pauvre conne moche », mais tout autant de la femme qui traite son compagnon de « minable impuissant », de « gros porc puant » ou de « pauvre type incapable ». Car les noms d’oiseaux que l’on se jette à la figure et autres agressions envers le partenaire ne brillent en général ni par leur finesse ni par leur imagination. Ils recyclent tout bonnement les clichés disponibles. Rien de particulier à en conclure.
Les racines, ou plutôt les paramètres des situations qui conduisent à des actes que l’on puisse qualifier de « violents » – en se gardant de tomber dans les pièges du prétendu « continuum » évoqué plus haut » –, relèvent plutôt, je dirais, de la nature d’une relation que d’un supposé « profil psychologique » des protagonistes de telles situations. Je n’utilise guère cette notion de « profil psychologique » pour ma part, elle aussi trop générale (par exemple « pervers narcissique », un « profil » censé expliquer toutes les relations « toxiques »), car chaque situation est singulière. Il me paraît plus utile d’essayer de comprendre par exemple la dynamique complexe – de part et d’autre – de relations qu’on peut à bon droit parfois décrire comme des relations « d’emprise ». À condition de ne pas se tromper sur ce dont on parle : l’« emprise », lorsqu’elle existe dans un couple, et le cimente plus fort que n’importe quoi d’autre, ce n’est pas réductible à un « bourreau » d’un côté, et à une « victime chosifiée » de l’autre. C’est une addiction commune, non symétrique mais pour autant mutuelle, à une folie de l’illimité du lien : un tourbillon fusionnel en réalité, délétère. Mais lorsque l’un des deux veut s’en extraire – s’en sevrer –, l’autre ne le supportera pas. Cela peut, on le sait, mener au pire.
Mais plus on sera à côté de la plaque dans l’appréciation de telles situations, particulièrement difficiles à dénouer, moins on saura se montrer capable d’y remédier. Il reste que beaucoup plus de femmes sont tuées par un compagnon ou ex-compagnon que l’inverse. Mais penser cette réalité en termes de « féminicide » – crime de « genre » – et de « « patriarcat » n’aide en rien à la décrypter et à les traiter.
Si nous pouvons être victimes de biais culturels dans la manière de traiter les violences ou leurs conséquences, ne passons-nous pas à côté des moyens de lutte et de prévention efficaces contre les auteurs de violence ?
Sabine Prokhoris : Bien sûr. Je parlerais en l’occurrence d’ailleurs plutôt de biais idéologiques que « culturels ». Il y a toujours des biais « culturels », forcément, mais un travail sérieux commence par essayer de les identifier, et de les analyser afin de parvenir à prendre le plus précisément possible la mesure des situations. Quant aux biais idéologiques, des slogans ne sont pas des outils d’analyse.
Ero Makia : C’est la conséquence inévitable. Comme le remarque Sébastien Dupont (« Distinguer les violences faites aux femmes pour mieux les combattre », 22/04/21), en raison du battage sur le « féminicide » (un terme totalement impropre car il ne s’agit pas de crimes misogynes mais de crimes de la relation), on ne s’attarde pas suffisamment sur des facteurs pourtant très spécifiques qui caractérisent le meurtre conjugal, « comme le fait que son premier mode opératoire soit l’arme à feu (ce qui pose des questions relatives au suivi des ports d’arme) ou la présence récurrente de troubles de la personnalité chez le criminel (ce qui soulève des enjeux de santé mentale) ».
Se focaliser sur un paradigme anti-patriarcal empêche également de considérer les principaux facteurs de violences conjugales, à savoir la pauvreté et l’alcoolisme. Dans tous les pays, les études montrent en effet que « la grande majorité des faits de violences conjugales sont des disputes communes à tous les couples (hétérosexuels et homosexuels), le plus souvent dans un contexte de pauvreté et de consommation d’alcool » : « Rachel Jewkes (2002) trouve un lien quasi universel entre pauvreté et violences conjugales » (Bonnet, §35). Et cette relation entre pauvreté et violence reste la même quand on considère d’autres types de violences intrafamiliales comme les violences contre les enfants ou la maltraitance des personnes âgées. Le mécanisme causal entre pauvreté et violences serait le stress, les difficultés économiques créant une forme d’anxiété propice à la violence. Si la consommation d’alcool n’est pas en soi une cause nécessaire ou suffisante pour expliquer les violences, « la conjonction de l’alcoolisme, de la pauvreté et d’attitudes qui légitiment la violence a un fort pouvoir prédictif. La corrélation entre violences conjugales et alcool est cohérente compte tenu de la forte relation entre alcool et violences de toutes natures » (Bonnet, §39). Les enquêtes montrent ainsi que « les violences sont corrélées à la vulnérabilité sociale – pauvreté, chômage, alcoolisme ».
L’incidence de la VC dans les couples de même sexe prouve elle aussi que le « patriarcat » n’est pas le bon outil pour les aborder et il est décourageant de voir que les causes qui pourraient être considérées et traitées si on sortait de ce paradigme sont ignorées. Causes qui sont toujours identiques, quelle que soit l’orientation sexuelle du couple : on retrouve une grande majorité de « violence situationnelle de couple », une même bi-directionnalité des violences et le même lien avec les difficultés économiques, la dépendance affective, la jalousie et l’alcool. « De même, les raisons les plus fréquemment citées pour rester – à savoir, l’espoir d’un changement et l’amour pour le conjoint – semblent universelles à l’expérience d’être battu », rappelle F. Bonnet (§43), qui ajoute : « Si la violence conjugale est la violence des hommes contre les femmes, alors elle ne devrait pas exister au sein des couples homosexuels » (§45). Cette idée reçue a donc fait perdre beaucoup de temps à la prise en charge de la VC dans les couples homosexuels.
Le refus féministe de prendre en compte les données de la psychologie, de la biologie ou de l’évolution, corrélée à leur croyance en l’idéologie du genre, met également les femmes en danger. Comme l’écrit L. Puech, certains professionnels « n’ont que le départ du foyer pour objectif de travail avec les victimes. Or, le départ et l’après départ sont justement les zones de danger les plus élevées en termes d’homicide. Eloigné en apparence de l’auteur des coups, on se trouve parfois plus en danger… ».
En raison de la croyance au « patriarcat » et à l’idée qu’il suffirait d’abattre cet ennemi imaginaire pour que les hommes modifient radicalement leur comportement et se transforment en femmes idéales exemptes de toute violence (une chimère, comme on l’a vu), on passe à côté des véritables sources de la violence et on se coupe du monde réel. Dans la vraie vie, les femmes sensées savent que la musculature d’un homme ou son impulsivité ne leur laisseront aucune chance si jamais les conditions d’un déferlement de violence se trouvaient réunies (Jonathann Daval ou Cédric Jubillar ne sont pas des armoires à glace et pourtant, ils ont supprimé leur femme en quelques instants) ; et qu’aucune incantation idéologique du genre n’a jamais empêché la commission d’un viol ou la perpétration d’un homicide conjugal. Et que de toutes façons, le « patriarcat » ne tue pas, que seuls tuent les coups, les armes, les poisons… et incidemment les violences psychologiques (par suicide ou en provoquant le déclin de la santé) ; toutes violences dispensées par l’un ou l’autre sexe sur des femmes, des hommes, des enfants, des personnes âgées. Il vaudrait donc mieux accepter les données biologiques du dimorphisme et de la différence des sexes et retrouver – ou développer – les codes pour composer avec. Accepter des différences ou des inégalités de force musculaire ou de taux de testostérone n’implique aucunement que l’on valide une infériorité ou une injustice de nature. Simplement, il existe d’autres pistes que le « tout patriarcal » (manifestement une impasse) pour lutter contre les violences conjugales.
- Voir aussi :