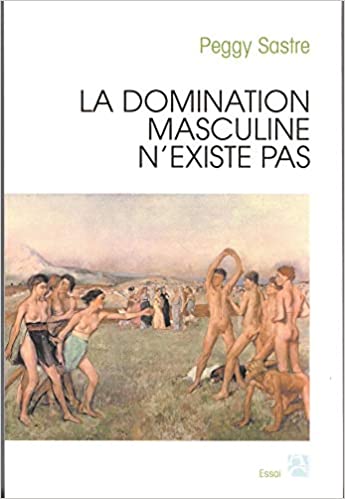- Texte également paru sur le site de l’Observatoire du Décolonialisme le 15/10/21
À l’heure où la rage et le ressentiment féministes saturent l’espace médiatique, La Domination masculine n’existe pas (2015) demeure un essai on ne peut plus actuel. Son titre, qui paraît compléter celui de Pierre Bourdieu, La Domination masculine (1998), prend cependant, tout comme son contenu, le contrepied exact du féminisme victimaire contemporain entièrement basé sur les théories issues du structuralisme et de l’approche socio-culturelle (« tout est construction sociale »). En reconnaissant le substrat irréductible des différences biologiques entre hommes et femmes et en les replaçant dans la perspective de l’évolution, l’approche de Peggy Sastre apporte non seulement un éclairage original et pertinent sur nos difficultés intersexuelles contemporaines, mais autant de pistes pour réfléchir aux solutions à leur apporter.
« Constructions sociales » contre sociobiologie : la guerre de tranchées
Parce qu’il réhabilite la biologie tout en mettant à la portée de tous une synthèse d’études issues de la recherche anglo-saxonne et américaine en sociobiologie, cet essai pourrait être vu comme un manifeste de l’évolutionnisme ou du darwinisme, un courant de pensée également appelé « psychologie évolutionniste », « évopsy » ou mieux encore, « évoféminisme » selon la terminologie forgée par Peggy Sastre (PS) elle-même.
Le lecteur non spécialiste ne pourra manquer d’être surpris par l’absence totale de références francophones dans l’imposante bibliographie rassemblée dans les notes (p. 227-272) – ce qui le mettra d’emblée sur la piste du rejet, voire de la sainte terreur, que semble susciter l’évolutionnisme dans l’université française. Ce que confirme Christophe Darmangeat : « Aujourd’hui encore, dans l’université française, le rejet – souvent violent – de l’évolutionnisme représente sans doute la première idée, et la plus fondamentale, inculquée à tout étudiant en anthropologie » (« Penser l’évolution sociale : quelques mauvais procès faits à l’évolutionnisme », 5/06/21).
En raison de cet attachement (une forme de chauvinisme, diront certains) au structuralisme et parce que le conflit semble réactualiser les vieilles querelles sur la nature et la culture ou sur l’inné et l’acquis, la recherche française en anthropologie sociale semble donc camper sur une posture quasi irrationnelle vis-à-vis de l’approche évolutionnaire. Alors que, comme l’écrit PS : « Pourquoi l’évolution ne serait-elle pertinente que pour expliquer ce qui se passe en dessous du menton et pas au-dessus ? », dénonçant au passage le « créationnisme mental » qui sévit toujours (p. 211).
Le darwinisme est « descriptif, pas prescriptif », comme elle le rappelle p. 15, précisant que si son vocabulaire (avec notamment la dialectique « coût/bénéfice » dans le contexte du viol) a pu choquer les âmes sensibles, décrypter les fondements évolutifs des violences sexuelles ne revient ni à s’y résigner, ni à les justifier et que la science ne requiert « ni indignation ni approbation morale et sociale ». Car l’objet de la sociobiologie n’est autre que « d’augmenter le bagage de connaissance que l’humanité peut exploiter pour comprendre et modifier le monde qui l’entoure » (p. 143-144). On voit difficilement en effet pourquoi le paradigme de l’évolution des espèces et des lois de la sélection naturelle, unanimement accepté dans les sciences de la vie, devrait être aussi violemment rejeté quand il s’agit des sociétés humaines – une idée qui prévaut est que l’évolution sociale aurait « depuis longtemps gagné son autonomie vis-à-vis de l’évolution biologique » (C. Darmangeat). Afin de pouvoir revenir sur ces questions en conclusion, je vais d’abord présenter, chapitre par chapitre, le contenu de l’ouvrage de PS.
Le livre est divisé en sept chapitres abordant les principaux thèmes qui nourrissent le féminisme contemporain (harcèlement sexuel, violences conjugales, « culture du viol », violence masculine, etc.), démontrant à chaque fois que l’hypothèse féministe d’un complot misogyne ourdi par une masculinité méchante et vicieuse, dans le seul but de mettre les femmes en esclavage sous la férule de la « domination masculine », ne tient pas. Ce que les féministes rebaptisent « patriarcat », oppression ou domination ne sont en réalité que des stratégies reproductives distinctes mais au final convergentes ; l’apparente « domination masculine » recouvrant même une réalité cruelle au sein de laquelle les hommes paient un très lourd tribut en termes de violence, déchéance ou relégation dans les bas-fonds de la société – un véritable gâchis masculin, en somme.
Ce sont les femmes qui décident
De même que la quatrième de couverture, l’introduction (« Entrer dans la caverne ») nous rappelle que les caractères masculins aujourd’hui vilipendés ont été choisis et valorisés pendant des millénaires par les femmes elles-mêmes – car ils étaient utiles à leurs intérêts reproductifs. « Qualités » masculines qui sont tout à la fois la témérité, la prise de risques, la force, mais aussi la violence voire la brutalité, autant de choses que ne peut plus entendre la féministe du XXIe siècle.
Une des notions de base du darwinisme (dont les fondements théoriques sont résumés en annexe, p. 217-226) concerne « l’incertitude de paternité » et le « choix cryptique féminin », c’est-à-dire le fait que l’homme ne peut jamais avoir la certitude absolue que l’enfant qui nait est bien le sien (il est difficile aussi de savoir exactement quand la femme est fertile) et surtout le fait que « les femmes sont un facteur limitant pour la reproduction des hommes et non l’inverse, car c’est à elles que reviennent le choix et la décision ultimes en termes de reproduction » (p. 223). Parce que l’être humain a toujours eu, et jusqu’à une période récente, une existence courte dédiée à la survie et la reproduction, toute son histoire, consciente ou inconsciente, va tourner autour du sexe, de la sexualité et de la maîtrise du marché sexuel (p. 11) – autant de questions qui obsèderont par ricochet les féministes d’aujourd’hui.
Le postulat du darwinisme est que l’homme qui évolue aujourd’hui dans un monde moderne qui s’est transformé très rapidement en à peine deux siècles et demi est sensiblement (pour ne pas dire exactement) le même, biologiquement parlant, que celui qui peuplait les cavernes il y a 30000 ans, voire bien davantage, vivant en groupements humains de petite taille et luttant âprement pour sa survie. Sinon qu’aujourd’hui, dans les sociétés occidentales prospères et pacifiées, la survie n’est plus un enjeu aussi crucial et la reproduction non plus, les femmes pouvant même passer la totalité de leur existence hors fécondité si elles le souhaitent. Des paramètres récents qui changent tout et dont la lecture féministe victimaire ne tient jamais compte, obnubilée qu’elle est à revisiter l’histoire de l’humanité et à appliquer sa grille de lecture ultra contemporaine à un monde qui n’existe plus.
« Une différence n’a jamais fait une hiérarchie »
Le chapitre 1, « Bilan de compétences », revient sur la question des « stéréotypes sexuels ou genrés », rappelant qu’ils ont longtemps été profitables aux deux sexes et qu’ils sont même toujours valables dans certaines disciplines scolaires (p. 21). Bien que cela soit inaudible pour les féministes, il s’agit effectivement d’une réalité. Les hommes sont toujours plus compétitifs en situation de négociation (p. 26) – ce qui explique au passage les différences de salaires des hauts revenus, directement liés à cette capacité de négociation – ; ils ne rejettent pas les notions de hiérarchie quand les femmes préfèrent l’égalitarisme et la coopération et ils valorisent plus ouvertement l’argent, alors que « les femmes ont mieux à faire que gagner de l’argent, reproductivement parlant » (p. 27-28). Les orientations professionnelles vers les STEM ou les sciences de l’ingénieur restent essentiellement masculines, les femmes préférant toujours, en dépit des intenses campagnes pour les pousser vers les sciences « dures », ce qui a trait aux personnes. Les hommes restent quant à eux davantage portés sur l’abstrait et l’objectal, en raison notamment d’influences hormonales prénatales (p. 31-32). PS développe également la question du dimorphisme sexuel et notamment des différences de psychologie et de cerveau entre les sexes, que l’évolution a façonnés différemment (p. 25). Certaines différences cognitives entre les sexes sont avérées : on sait par exemple de manière indiscutable que les hommes sont plus forts en aptitudes spatiales pour prédire la rotation alors que les femmes sont meilleures en verbal, grammaire, orthographe ou mémorisation de mots (p. 30).
Ces passages ont provoqué une violente animosité de la part d’Odile Fillod, qui a poussé le journal Le Monde à pilonner le travail de Peggy Sastre, suscitant en réaction une levée de boucliers de la part de spécialistes venus défendre le sérieux des études sur le cerveau auxquelles PS faisait référence. La querelle sur les différences de cerveau masculin et féminin court toujours, en raison d’une idéologie féministe hégémonique qui refuse dogmatiquement d’accepter les résultats des sciences de la vie. À titre d’exemple, j’écoutais ce week-end le physicien et médecin Denis le Bihan sur CNews (dans l’émission « Repères » du 10/10/21) exposant de manière passionnante ses travaux d’imagerie médicale sur le cerveau. Quand il a rappelé incidemment que les cerveaux des hommes et des femmes étaient différents, il a été immédiatement interrompu et empêché de poursuivre par un Jean-Pierre Elkabbach qui vociférait « Et l’égalité, et l’égalité ? », comme s’il s’agissait d’une prescription religieuse.
Un « plafond de verre » mais aussi un « plancher de verre » pour les femmes
Le chapitre aborde également les différences de salaire. À l’encontre de la doxa dominante, Peggy Sastre signale que chez les célibataires sans enfants de moins de 40 ans, on ne relève aucun écart de salaire significatif (p. 28) et que si les femmes sont effectivement plus rares tout en haut de la pyramide, ce sont bien les hommes qui s’entassent au plus bas de l’échelle sociale, une réalité que les femmes, qui privilégient la prudence et la dépendance, connaissent moins et que les féministes ne veulent entendre. De par leur témérité et leur égoïsme, on retrouve davantage d’hommes en haut de l’échelle sociale, certes, mais ce n’est pas non plus sans raisons, sans efforts et sans sacrifices. Ils n’ont pas non plus d’horloge biologique (p. 33-34).
Les hommes sont les premières victimes de la violence, rappelle PS au Matin (« L’évolution a fait les machos », 23/12/2015), « puisque ce sont eux majoritairement qui meurent en raison de la brutalité sous toutes ses formes. Ils sont aussi les plus vulnérables : les hommes sont surreprésentés parmi les SDF ou les détenus. Les femmes, si elles subissent un plafond de verre, ont également sous les pieds un plancher de verre qui les soustrait majoritairement à l’extrême pauvreté. »
PS dénonce à juste titre l’égalitarisme forcené dans le choix des orientations, ce qui ne va pas sans créer de nouvelles barrières et un nouvel arbitraire pouvant forcer les gens à faire autre chose que ce qu’ils veulent réellement – problème qui se pose actuellement dans les pays scandinaves où les féministes se demandent comment elles peuvent forcer les filles à choisir des métiers de garçons alors qu’elles ne le souhaitent pas intimement. Il ne faut pas « se laisser aveugler par des considérations idéologiques qui font du réel le début d’une insulte, même si elles ont l’air de nous placer d’office dans le camp du bien », écrit PS p. 36.
La femme chasseresse
Le sujet de la femme chasseresse, qui fait encore l’actualité ces jours-ci, est abordé (p. 30) à travers le thème de la prise de risques. PS rappelle que dans les sociétés jadis qualifiées de « primitives », sur 179 étudiées, il n’en existe aucune où les femmes ont l’exclusivité de la chasse et que dans 166 d’entre elles, les hommes sont seuls à la pratiquer. C. Darmangeat confirme cet état de fait dans sa critique du documentaire « Lady Sapiens » diffusé tout récemment (« Lady Sapiens : les femmes préhistoriques, d’un stéréotype à l’autre ? », 11/10/21) : sur les cinq continents, les femmes sont « presque universellement exclues du maniement des armes tranchantes ou perçantes les plus létales, comme la lance ou l’arc, et donc de certaines activités spécifiques ». À part chez les Agta des Philippines, « aucune population de chasseurs-cueilleurs observée en ethnologie n’a jamais permis aux femmes de manier lances et arcs et d’intervenir ainsi dans la mise à mort sanglante du gros gibier ». Et encore, ces dernières le faisaient, car c’était un peuple « qui se procurait ses produits végétaux auprès d’agriculteurs voisins, et qu’il était donc tout entier spécialisé dans l’acquisition de ressources alimentaires carnées ». Quant à l’affirmation « selon laquelle 30 % à 50 % des chasseurs de l’Amérique ancienne étaient en réalité des chasseresses, elle repose sur des éléments tout aussi fragiles ». Seule une femme possédait dans sa sépulture des objets de chasse au gros gibier, mais la fiabilité avec laquelle son sexe a été déterminé n’est que de 80% (or il faut un minimum de 95% pour être certain). Les actuels développements féministes sur les femmes chasseresses dans les sociétés primitives ne reposent donc en définitive sur rien.
Harcèlement : les hommes veulent du sexe, pas du pouvoir
Le chapitre 2, « Sphères du harcèlement », traite du harcèlement sexuel, « une notion incubée dans les cercles féministes d’un pays où les mutations sexuelles du marché du travail ont été les plus rapides et les plus patentes : les États-Unis », mais une notion problématique car n’ayant pas reçu de définition universelle (p. 44). Les féministes s’obstinent à voir le harcèlement sexuel comme un « outil du patriarcat » fonctionnant sur un besoin typiquement masculin de puissance et domination sur les femmes qui n’aurait rien à voir avec le sexe, ce que PS conteste formellement. C’est bien le pouvoir qui est un outil du sexe, et non l’inverse : le harceleur harcèle en premier lieu parce qu’il a envie de copuler. À ce titre, elle relève que les harceleurs sont le plus souvent des collègues de statut égal ou inférieur (p. 48) et que selon le contexte et/ou la personne qui les endosse, des comportements identiques pourront être considérés comme neutres, bienveillants, si ce n’est séduisants et attirants (p. 51). Aucune de ces assertions n’est gratuite mais fondée sur une ou plusieurs études.
Si l’on met en regard le fait que les victimes sont majoritairement jeunes, célibataires et perçues comme vulnérables et que pour des raisons évolutionnaires, les hommes sont portés à voir des signaux sexuels là où il n’y en a pas toujours, le harcèlement sexuel pourrait être interprété comme une manière de « vérifier la disponibilité » (p. 54-55) valant comme un « avantage reproductif pour l’homme », parmi d’autres.
Pas la bonne personne et pas les bons codes
L’indice de sociosexualité mesure le profil sexuel général d’un individu, du « coincé » (sociosexualité basse) à « l’obsédé » (sociosexualité haute) ; il est également à noter que les personnes à sociosexualité élevée sont, en tendance, jugées les plus séduisantes (p. 54). PS rappelle ensuite que « personne, nulle part n’a envie de harceler tout le monde » et que si dominer était leur but, les harceleurs cibleraient des gens à la sociosexualité basse ; or c’est l’inverse que l’on constate : les hommes à sociosexualité haute harcèlent préférentiellement des femmes à sociosexualité haute également. Curieusement (mais pas tant que ça), ce sont les femmes à sociosexualité basse qui vont davantage se sentir harcelées – alors qu’elles le sont statistiquement moins que les autres (p. 57).
PS revient également sur le phénomène du harcèlement de rue, rappelant que le problème vient surtout du fait qu’il s’agit d’hommes qui n’ont aucune chance, manipulant « de mauvais codes de séduction, utilisés par les mauvaises personnes » et que cette figure de l’« homme de la rue » s’oppose radicalement à l’hypergamie – le fait de choisir comme partenaire sexuel, à plus ou moins long terme, quelqu’un d’un statut (social, intellectuel) plus élevé que le sien ; ce à quoi l’évolution prédispose les femmes (p. 59).
Toujours à l’encontre du discours dominant, PS rappelle aussi qu’un « petit tiers de femmes utilisent sciemment la tactique du non qui veut dire oui » car elle a pu être avantageuse : temporiser le consentement permet à la fois de tester l’homme et de ne pas passer pour « trop facile ». Parce que les femmes ont aussi été sélectionnées pour faire les difficiles, un non peut parfois signifier « essaie encore » (p. 62-63). Et de rappeler que les études sur le harcèlement ne demandent jamais aux femmes combien de fois elles ont répondu favorablement aux sollicitations… quand on sait que 30 % des couples se forment au travail (p. 64). Il ressort encore une fois que le harceleur se sert de son pouvoir pour copuler et que si ce dernier peut être un moyen, le sexe en est toujours la fin (p. 65).
Le chapitre 3, « Secrets de famille », éclaire à la lumière du darwinisme le sujet complexe des violences conjugales. Le chapitre revient d’abord sur la notion évolutionnaire centrale de l’incertitude de paternité et sur son corollaire, le désinvestissement paternel : « Un homme est plus enclin à s’investir pour ses enfants biologiques que pour ceux que sa compagne aura faits avec un autre homme, un phénomène qui reste stable parmi différentes cultures » et que de nombreuses études confirment. « Du fait du caractère antithétique de leurs dynamiques reproductives, chez les humains comme dans la plupart des espèces à reproduction sexuée, le mâle est celui qui délaisse le plus sa progéniture », une donnée de l’évolution que ne contredisent pas les actuels foyers monoparentaux – même si divers facteurs nuancent cette situation, comme le fait que le plus le père sera éduqué et plus il sera enclin à payer la pension alimentaire. Mais c’est quand la mère se remarie que le père a le plus de chances de cesser de payer cette pension. Une femme est toujours certaine d’être la mère de ses enfants alors qu’un homme non ; raison pour laquelle avant l’âge d’un an les bébés ressemblent souvent davantage à leur père ; et c’est aussi ce que disent ceux qui le regardent – une manière ancestrale de protéger la mère et l’enfant d’une mise à mort possible (p. 72-73).
La violence conjugale à la lumière de la perspective évolutionnaire
On peut selon cette approche faire ressortir les trois paramètres fondamentaux de la violence domestique masculine : si la jalousie sexuelle en constitue le fondement principal, la violence conjugale serait également un double moyen de punir et de prévenir l’infidélité sexuelle, ainsi qu’une stratégie palliative à cette forme d’infidélité (p. 78). Elle pourrait donc s’interpréter comme des « stratégies préventives et palliatives », du fait que l’agresseur se sente (ou est réellement) menacé dans sa capacité reproductive et dans la dispersion de ses gènes (p. 79). Il faut encore rappeler que cette explication darwinienne ne se veut qu’une observation froide et en rien une justification de la violence.
Le fléau de la jalousie touche les deux sexes. L’intensité de cette émotion est ressentie identiquement que l’on soit un homme ou une femme ; ce qui va différer est le type de jalousie ressentie : elle sera plutôt d’ordre affective et sentimentale chez les femmes et sexuelle chez les hommes et cette dichotomie est universelle (p. 81-82). Entre la jalousie morbide et la jalousie non pathologique, il n’existe de plus qu’une différence de degré et non de nature. Mais il existe une dangerosité propre à la jalousie masculine car celle-ci est un catalyseur spécifique de violence domestique, ce que confirment nombre d’études (p. 86). Elle porte aussi plus souvent sur des femmes ayant eu des enfants d’un précédent partenaire (p. 87), en raison comme on l’a vu plus haut, de la réticence naturelle de l’homme à entretenir les enfants d’un autre.
Les études montrent aussi que l’âge de la femme joue un rôle : les violences conjugales ont tendance à baisser à mesure que la femme approche de la ménopause et du tournant des 45 ans : les femmes en âge de procréer en sont statistiquement dix fois plus victimes. Il s’agirait donc possiblement d’une stratégie inconsciente pour « contrôler la capacité reproductive de la femme ». De ce point de vue, le viol conjugal peut même être considéré comme une technique de « compétition spermatique » (le sperme du mari venant immédiatement concurrencer celui de l’amant putatif) (p. 91).
Dans le cas de l’uxoricide (le meurtre de l’épouse ou de la compagne), terme qui devrait supplanter l’appellation impropre de « féminicide » (car ces femmes ne sont pas tuées parce qu’elles sont des femmes mais parce qu’elles sont l’épouse particulière d’un homme particulier), la jalousie et la suspicion d’infidélité sont relevées dans 80% des cas (p. 93). Le crime conjugal pourrait alors s’expliquer évolutionnairement parlant pour son côté dissuasif plus que punitif, parce qu’il envoie un message aux potentiels concurrents : l’homme donne ici un exemple de ce qu’il est capable de faire. La même logique s’appliquerait au caractère dissuasif des crimes d’honneur auxquels le chapitre 4, « Aux champs d’honneur »,est dédié.
Les études sur le sujet ont fait ressortir que partout dans le monde, un niveau de violence élevé accompagnait les sociétés pastorales, bien plus que les sociétés agricoles (p. 97). Parmi ses manifestations, on retrouve la vendetta ou, comme chez les sudistes blancs américains, la culture de l’honneur. Chez ces derniers, un peuplement d’origine pastorale (des bergers écossais et irlandais, alors que le nord des États-Unis avait reçu des colons venus des grands centres céréaliers anglais, allemands ou hollandais) la violence était endémique mais acceptée, car considérée comme « réactive » à des insultes remettant en question l’honneur de l’insulté (p. 97-103). PS souligne aussi le rôle des femmes dans cette culture de la violence (p. 104) : elles la défendaient ouvertement et éduquaient leurs enfants en ce sens. Les confédérés de retour de la guerre avouaient même qu’ils avaient « peur des femmes s’ils rentraient vaincus car elles auraient eu honte d’eux » (p. 106). De la même manière, les femmes attisent le ressentiment des hommes de leur clan, quitte à les pousser à commettre des « actes désespérés ».
Ce goût pour la violence répond à des mécanismes évolutifs et on attribue même une « existence autonome » à la culture de l’honneur : bien que le pastoralisme ne soit plus structurant comme autrefois, cette culture s’est exprimée ensuite dans le « romantisme guerrier » par exemple ou lorsque « lâches et traitres sont toujours assimilés » dans les sociétés développées. Il s’avère de plus que très peu d’hommes sont réellement indifférents à l’insulte : il s’agissait à l’origine d’un facteur de survie afin de pouvoir conserver partenaires et ressources. Il existe donc encore une différence de degré mais pas de nature entre les hommes appartenant aux cultures de l’honneur ou non (p. 107-109).
Le chapitre 5, « Antécédents de violence », s’attache justement à rechercher les origines de cette violence, en signalant d’emblée que la violence est un « phénomène disproportionnellement masculin » répondant à des facteurs biologiques et que cette violence a été sélectionnée afin de résoudre des problèmes adaptatifs aussi majeurs que la compétition pour l’accès aux ressources, que celles-ci soient alimentaires, territoriales ou sexuelles. Il y aurait donc « une logique derrière peu ou prou tous les actes de violence » (p. 111-113).
Il en va ainsi chez les animaux non humains, où la violence s’inscrit dans les deux cadres théoriques darwiniens de la sélection sexuelle et de l’investissement parental : dans le contexte de la compétition pour le sexe, les mâles ciblent d’autres mâles pour accéder à des femelles ; une violence intrasexuelle parfois si coûteuse en vies qu’elle peut alors être ritualisée (p. 115). On relève également chez les animaux des cas d’infanticide et d’avortement sélectif (p. 120), les femelles préférant se reproduire avec le meilleur mâle, « celui qui est tout en haut de la pyramide » (p. 123).
Chez les humains – chez lesquels il convient également de faire voler en éclats le « mythe du bon sauvage », car les études montrent sans ambiguïté que la violence humaine n’est en rien une invention récente « réactive » à la modernité –, le recours à la violence s’inscrit dans le même type de compétition pour les ressources énergétiques et sexuelles (p. 125-126).
[Sur la violence masculine, voir aussi : William Buckner, « Pourquoi les hommes sont plus violents que les femmes », Le Point, 10/12/18]
Le pouvoir des femmes
À l’opposé du narratif féministe victimaire, le darwinisme démontre que « les femmes ont été les instances décisionnelles de l’évolution » (p. 127), car « si quelques hommes ont eu beaucoup d’enfants, beaucoup d’autres en ont eu peu ou pas du tout » (p. 129) : l’humanité (celle qui a pu se reproduire) est en réalité faite de deux fois plus de femmes que d’hommes (p. 130). Ce point est à rapporter au paradigme darwinien qui pose comme fondement la compétition pour la survie et pour la reproduction et développe le concept de « valeur adaptative » (ou fitness) : certains individus sont plus efficaces que d’autres. C’est dans ce cadre que les compétitions « intrasexuelle » et « intersexuelle » prennent tout leur sens, de même que l’importance de la sélection sexuelle (cf. « Rudiments théoriques », p. 219-222).
Selon cette théorie, le sexe le plus violent sera toujours celui dont l’investissement parental est le moindre et le succès reproductif le plus variable – car il est celui qui doit prendre le maximum de risques pour accéder à des partenaires. Et les femmes ont apprécié et même recherché ce goût de risque car, aussi contre-intuitif que cela paraisse aujourd’hui, « les femmes choisissent les brutes » : plus un homme est violent et plus il a du succès auprès des femmes. Il en va de même chez les femelles chimpanzés (p. 131-132). En biologie comme ailleurs, l’histoire est toujours écrite par les vainqueurs et les perdants voient leurs gènes disparaître avec leur dernier souffle. C’est ainsi que chez les hommes, la mortalité violente concerne toujours majoritairement, aujourd’hui comme au temps de nos ancêtres, des hommes jeunes et pauvres (p. 136).
L’instinct de violence (comme la jalousie, on l’a vu plus haut) est partagé à égalité par les deux sexes : si, dans une étude, 80% des hommes avouent des idées meurtrières, 60% des femmes le font aussi. La différence est qu’ensuite les femmes auront préférentiellement recours à l’agression indirecte ou relationnelle – ragots, dénigrements, critiques, généralement sans risques de représailles (p. 133). Des études ont aussi montré que quand les femmes ovulent, elles jugent plus mal les autres femmes. Cette agressivité s’inscrit pleinement dans ce que le darwinisme appelle la « compétition intrasexuelle ».
Le darwinisme postule en effet une « asymétrie fondamentale entre les intérêts reproductifs des deux sexes, elle-même relevant d’une inégalité biologique irréductible » : la femme produit un ovule par mois, les hommes des millions de spermatozoïdes par jour, puis la femme vit la grossesse, l’accouchement, l’allaitement, etc. « Il s’ensuit une asymétrie dans la théorie de l’investissement parental : le succès copulatoire n’est pas forcément synonyme de succès reproductif : il faut que la descendance survive à son tour. Il y a donc combinaison de deux processus distincts : conquête du partenaire et investissement parental » (cf. p. 222).
Le phénomène de la guerre a aussi des explications évolutionnaires : « Entrer en contact avec un étranger de la même espèce est le plus puissant déclencheur d’agressivité », selon David Livingstone Smith (p. 139). Il s’avère également que les hommes subissent davantage le racisme et la discrimination sur des critères ethniques que les femmes (p. 140). Si l’on relève une forte sensibilité masculine à la différence, les femmes se montrent en général plus ouvertes et tolérantes à la différence et donc moins partantes pour la guerre (elles ont pour habitude, chez les femelles animales, de se soumettre au vainqueur, parfois de bon cœur, car leur descendance sera également plus puissante).
Le chapitre 6, « Cultures du viol » est lui aussi d’une actualité toujours brûlante. Après les précautions d’usages suscitées par les intenses réactions émotionnelles que le sujet déchaîne immanquablement chez les féministes, PS rappelle cette définition de 1975 du viol par Susan Brownmiller : « Processus délibéré d’intimidation par lequel tous les hommes maintiennent toutes les femmes dans un état de peur constant » (p. 146) et l’on comprend mieux les origines d’une certaine forme de paranoïa et d’exagération féministes.
Comme pour le harcèlement sexuel (chap. 2), ce chapitre revient sur la question de déterminer si le viol est une affaire de sexe ou de domination et la réponse est claire : il s’agit de sexe uniquement. Comme le fait remarquer PS, on ne voit pas pourquoi un homme en passerait par le sexe pour avoir du pouvoir, ni pourquoi le viol ferait si peur aux femmes, au point de les assujettir. C’est en réalité l’inverse : un homme qui viole est un homme qui veut du sexe. En termes darwiniens, le viol peut s’appeler « coercition sexuelle » : le fait pour un mâle d’augmenter les chances que la femelle s’accouple avec lui plutôt qu’avec un autre mâle (p. 147).
Si le viol est un phénomène universel, rencontré dans toutes les sociétés, toutes les cultures humaines et dans un grand nombre d’espèces animales, il n’en est pas moins conditionnel, car tous les hommes ne vont pas violer, ni le faire pour les mêmes raisons. On doit d’emblée éliminer la cause pathologique : la corrélation entre pathologie et agression sexuelle étant plutôt maigre (p. 150). Il ressort également une hétérogénéité du viol : il apparaît au final comme un « faute de mieux » pour le mâle qui a tout intérêt à trouver d’autres moyens pour garantir la transmission de ses gènes (p. 152).
Chez les singes, notamment les chimpanzés et les orangs-outangs où le viol est monnaie courante, les violeurs ciblent surtout les femelles fertiles ; l’objectif inconscient étant manifestement d’augmenter leurs chances de reproduction (p. 153). À l’inverse, il n’y a pas de copulation forcée chez les bonobos. On relève en tout cas, dans les harems de singes, un goût assumé des femelles pour les mâles dominants, car « être soumise à un mâle, c’est aussi profiter de sa protection » (p. 161).
Chez les humains, contrairement aux animaux, la coercition sexuelle aurait davantage à voir avec le contrôle durable d’un accès à des partenaires sexuelles qu’avec une simple augmentation des chances de les féconder. Ceci est appuyé par le fait que l’on trouve des violeurs dans toutes les classes sociales, y compris chez des hommes qui n’ont aucune difficulté à trouver des femmes ; que le viol conjugal existe (pour dissuader d’aller voir ailleurs et pour la compétition spermatique, comme vu au chap. 3) et qu’il est souvent accompagné d’autres formes de violences, psychologiques notamment (p. 162).
Paradoxes féminins
Du côté des femmes, on relève une relative « passivité » des femelles humaines face au viol car celles-ci ont besoin de l’investissement paternel pour assurer la survie de leur descendance (p. 163), de même que des stratégies de contre-adaptation en raison de l’énorme potentiel traumatisant du viol pour une femme, à savoir le risque de devoir assumer un enfant tout en perdant l’assistance de son partenaire routinier (p. 164).
C’est ainsi que de manière de nouveau contre-intuitive – mais logique d’un point de vue évolutionnaire –, plus le viol impactera ses capacités reproductives et plus la femme en souffrira psychologiquement ; le traumatisme est donc plus grand pour les femmes en âge de procréer que pour les femmes ménopausées. Il en va de même pour les femmes mariées, car le viol hypothèque davantage leur avenir. Dans ce cas, moins le viol est violent et plus il est traumatisant, la femme pouvant avoir plus de mal à prouver sa bonne foi. La cause en est toujours la même : une grossesse non désirée (p. 165). Pour les mêmes raisons, un viol conjugal ne sera pas celui dont une femme aura le plus peur car c’est « moins pire que d’être violée par un inconnu » (p. 176).
On relève également, concernant le viol, un « syndrome du jeune mâle » et « de la jeune femelle ». Chez les hommes, la sélection favorise les traits associés à la prise de risques, un état de fait que le mariage atténue sensiblement, une fois que l’homme n’a plus besoin de chasser les conquêtes. C’est ainsi que des criminels peuvent « se ranger » et que le pic des agresseurs se situe entre 18 et 30 ans (p. 167). Parallèlement, chez les femmes, la majorité des victimes a entre 16 et 24 ans. Il en ressort que le viol est davantage à voir comme une stratégie reproductive que comme un moyen masculin d’asseoir domination, pouvoir et oppression. Les hommes violent généralement les femmes les plus attirantes et les plus susceptibles de tomber enceintes (des statistiques qui ont le don d’exaspérer les féministes, mais qui n’en sont pas moins la réalité), de même que des jeunes femmes qui ont quitté le foyer familial et n’ont pas encore intégré un foyer conjugal, et ne sont seront donc ni protégées ni vengées. Un élément allant dans ce sens est que, de manière toujours aussi contre-intuitive, le taux de fécondité des viols est identique à celui des rapports consentis.
Il existe cependant des mécanismes féminins de prévention contre le viol. On a pu ainsi démontrer que quand les femmes ovulent, elles ont davantage de force musculaire et que les femmes ovulantes recourent à des stratégies de prudence, de vigilance et de méfiance : plus les femmes sont fertiles et plus elles ressentent les hommes comme « sexuellement coercitifs ». Elles sont également plus racistes quand elles ovulent (p. 171-172). Ces éléments peuvent être rapportés à la seconde des citations ouvrant le livre (p. 7), à propos du réflexe normalement sensé de toute jeune femme consistant à prendre en considération la dangerosité des jeunes garçons.
Le chapitre 7, « Une arme de survie et de procréation massive », est consacré à la religion et en particulier au terrorisme islamiste, toujours afin de démontrer que la violence humaine s’inscrit dans une logique évolutionnaire. Les religions ont toutes comme point de départ une commune quête de sens : « trouver de l’action, de la cause, de l’intention (voire de l’intelligence) partout, même (surtout) là où il n’y a que le silence éternel des espaces infinis » (p. 182), un réflexe auquel s’adjoint la « détection hypersensible », cette capacité humaine consistant à prendre en compte un danger invisible afin de s’en protéger. Les deux vont conférer ces points communs à toutes les religions : l’omniscience sociale et stratégique des divinités et la propension des humains à croire sans voir (p. 185). D’un point de vue évolutionnaire, il est démontré que les religions augmentent les comportements prosociaux et la coopération au sein des groupes, contribuant à maximiser ses ressources, mais aussi à se créer un ennemi : « aimer les siens, c’est haïr les autres » (p. 187).
Comme les violeurs, les terroristes ne sont pas imputables d’anomalies anthropologiques. La pauvreté n’est pas non plus un facteur prédictif et ils ne sont ni porteurs de maladies mentales graves, ni même dépressifs (p. 190). La religion apparaît finalement comme un outil et non une cause du terrorisme, lequel présente des parentés avec les « rites de passage » car touchant identiquement la fin de l’adolescence et le début de l’âge adulte (p. 194). L’action terroriste, pour ces jeunes hommes qui tiennent à leur groupe, apparaît même comme un facteur de coordination et de coopération au sein de ce groupe : non seulement ces jeunes se soumettent à des rituels religieux rébarbatifs, mais leur sacrifice profite au cercle familial du sacrifié et donc à ses gènes (p. 198). Les kamikazes améliorent même parfois concrètement la vie de leur famille (les martyrs palestiniens peuvent toucher jusqu’à 25000 € des organisations terroristes) : il s’agit donc d’un investissement dans la descendance des porteurs de leurs gènes. Les représailles israéliennes qui bombardent les maisons de leurs familles trouvent ici leur justification d’un point de vue évolutionnaire.
La domination masculine existe-t-elle ?
En conclusion, PS propose de « Sortir de la caverne » : notre environnement a tellement changé que le fossé séparant les intérêts sexuels des hommes et des femmes s’est fortement rétréci. En définitive, nous rappelle-t-elle, « la domination masculine n’existe pas, elle n’est qu’une des deux faces de la sélection et du conflit sexuels, moteurs de processus en miroir qui ont vu les hommes dominer parce que les femmes ont pu aimer la domination et les femmes se soumettre parce que les hommes ont pu aimer la soumission » (p. 210).
Dans une interview aux Inrocks (10/10/15), elle nuance cette position : « Il ne faut pas s’arrêter au titre du livre : je voulais exprimer que la domination masculine n’est pas celle que l’on croit, mais qu’elle existe bien. Je ne regrette pas, je suis très nulle en titre, et celui-là est le moins pire, même si je n’en suis pas particulièrement contente. Il a failli s’appeler Les Déchets, mais c’était trop vague, ou Une autre histoire de la domination masculine, qui ne se remarquerait pas dans l’univers ultra concurrentiel de l’édition. »
Il ressort tout de même de l’exposé de PS que la domination masculine n’est qu’apparente : la violence létale masculine est sans conteste immensément supérieure, la propension au viol et au forçage également, l’appétence pour la guerre, la compétition et le sang aussi. Mais les hommes sont incomparablement les premières victimes de cette violence, tant leur statut, en termes de reproduction, est défavorisé ; le gâchis masculin est immense et le nombre d’hommes qui meurent jeunes, non seulement sans se reproduire mais sans même avoir accès aux femmes, ou qui peuplent les bas-fonds de la société, la rue et les prisons, est sans commune mesure avec la situation plus prudente et plus protégée des femmes. Comme pour la courbe de Gauss du QI, où l’on retrouve davantage d’hommes aux deux extrémités (chez les déficients et chez les génies, alors que la majorité des femmes se regroupe autour de la moyenne), la situation des hommes couvre tout le spectre des situations, de la misère au succès, que ce soit dans la compétition pour le sexe comme pour le statut social.
Il n’est pas tenable de prétendre que la situation des femmes est défavorisée par rapport à celle des hommes ou qu’elles en sont les éternelles victimes : partout et depuis toujours, le garçon qui naît court un risque bien supérieur à la fille de ne pas arriver à l’âge adulte ou de mourir sans s’être reproduit. Pour quelques hommes qui occupent le haut de la pyramide, une quantité ont eu, ou auront encore, des destins tragiques.
Si la maternité a pu donner du pouvoir aux femmes (mais pas seulement, car elle les fragilise en même temps), les femmes sont d’abord les reines de la compétition sexuelle ; leur puissance sur le marché sexuel (rappelons que la sexualité reste le territoire fondamental de toute la rhétorique féministe) découle du fait que les hommes s’entretuent depuis toujours pour les séduire ou les féconder. Les hommes n’ont pas seulement cherché à « contrôler le pouvoir reproductif des femmes », ils ont surtout cherché à y accéder, ce qu’expose en détail le livre de PS.
Dans son article sur « Lady Sapiens », C. Darmangeat démonte utilement quelques faussetés véhiculées par celles qui défendent toujours le mythe d’un « matriarcat » primitif (« une telle configuration, où les femmes auraient détenu le pouvoir sur les hommes, n’a jamais été observée nulle part sur la planète ») ou des femmes chasseresses (voir plus haut), et même le positionnement de Françoise Héritier qui voulait voir l’infériorisation des femmes simplement inscrite dans les mentalités (cf. « Comment l’anthropologie sociale éclaire la perspective féministe », 2019). Pour autant, je ne souscris pas à sa vision post-marxiste d’une subordination des femmes relative à la division sexuée du travail ou à l’exploitation genrée qui en découlerait. Il me semble au contraire que la puissance ontologique des femmes est une réalité qui s’observe indépendamment de tout rôle économique – car il s’agit d’un invariant biologique que le darwinisme explique de manière particulièrement féconde.
Il faut rappeler encore que la différence biologique des sexes n’implique en soi ni hiérarchie ni domination d’un sexe sur l’autre. La biologie est ; elle n’a que faire de son interprétation victimaire ou morale. Je suis de ceux qui pensent que les structures sociales viennent en second et s’adaptent comme faire se peut au substrat biologique et à ses invariants. Sur son site, dans un commentaire, C. Darmangeat expose justement ses doutes quant à la validité de la théorie évolutionniste : « Face à un trait culturel observé comme sinon universel, du moins largement répandu, comment la psychologie évolutionniste l’attribue-t-elle à une disposition cérébrale sélectionnée par la biologie il y a 100 000 ans, et non à une possible adaptation sociale intervenue à un moment quelconque de l’évolution des organisations humaines ? ». Je dirais que la réponse est dans le livre de PS : parce que les invariants les plus fondamentaux (sur la violence, le viol, l’investissement paternel, la compétition pour les ressources, etc.) se retrouvent toujours de manière comparable sinon identique chez les animaux non humains. Il y aurait donc bien un substrat biologique encore plus ancien que les plus anciennes sociétés humaines.
C. Darmangeat pose aussi cette question : « À cette difficulté s’en ajoute une autre, bien plus fondamentale encore, qui grève toutes les recherches en sociobiologie ou en psychologie évolutionnaire : le fait qu’un trait (culturel, comportemental ou psychologique) soit largement partagé traduit-il nécessairement une disposition innée, héritée de la sélection naturelle ? ». La réponse est la même : quand on le trouve à l’identique dans les sociétés animales, on peut supposer que la sélection naturelle y soit pour quelque chose, oui (sur le même sujet : William Buckner, « Pourquoi les hommes sont des primates comme les autres », Le Point, 10/02/19).
J’ajouterais à titre personnel que ce qui est exposé dans ce livre résonne parfaitement avec mes propres expériences de vie et mes observations. Moi aussi, j’ai dit non quand je pensais oui (et pas qu’une fois) ; comme PS, je n’ai pas été traumatisée par des expériences sexuelles que les féministes qualifieraient d’insurmontables, je n’ai jamais souffert du harcèlement sexuel (qui me fait toujours sourire ou hausser les épaules) et plus encore, je n’accepte pas de me faire rhabiller en victime ontologique ou sociale de la domination masculine au prétexte que je serais une femme. De toute ma vie, je n’ai jamais croisé la domination masculine, je n’ai jamais été opprimée par un homme et je m’estime proprement insultée de me voir associer, du simple fait de mon appartenance au sexe féminin, à la complainte victimaire universelle.
Je viens de la campagne bretonne, de contrées où au milieu du XXe siècle, on vivait encore comme au Moyen Âge – ou presque : certains hameaux n’ont été électrifiés que dans les années 50 voire 60, il n’y avait pas d’eau courante et les gens vivaient sur la terre battue, quasiment en autarcie avec les produits de leur ferme (chacun faisait son pain, son beurre, son pâté, sa saucisse, son cidre, etc.). J’ai connu ma grand-mère, sa parentèle et son voisinage, tous issus de ce monde et chaque fois que je lis la prose du féminisme victimaire, je repense à ces hommes et à ces femmes. Je pense surtout aux coups de trique que ma grand-mère, qui maniait comme personne la fourche et le manche à balai, aurait collés à celles qui seraient venues lui expliquer qu’elle était soumise à la domination masculine. Son premier mari était mort en mer à l’âge de 31 ans (il était terre-neuvas, il partait pour six mois de campagnes éreintantes de pêche à la morue dans des mers glacées) pendant que restée à terre, elle était couturière ; ensuite elle s’est remariée et avec son mari, ils sont devenus métayers. Tous deux travaillaient dur et s’activaient du matin au soir, mon grand-père ne se posait quasiment jamais. C’est toujours lui qui, avec les hommes des fermes voisines, prenait en charge les travaux les plus pénibles ou les plus physiques ; ma grand-mère faisant le reste. La vie était rude mais ils étaient heureux et ma mère conserve une nostalgie sans fond de cette existence. J’ai beau gratter, je ne vois pas du tout à quelle oppression masculine ma grand-mère, une femme de caractère (et c’est peu de le dire), pouvait bien être soumise. Le corps de mon grand-père l’a lâché le premier et ma grand-mère l’a suivi dans la tombe quelques mois plus tard – à 81 ans, elle n’avait pas envie de vivre sans lui. Je considère que ces vies simples et courageuses n’ont pas à être réécrites à la lumière de je ne sais quel fantasme anti-patriarcal qui viendrait salir, à grands coups de « culture du viol », de « masculinité toxique » ou de « complot misogyne » – l’histoire de leur vie ; j’estime même que ce serait faire gravement offense à leur histoire d’amour.
Je considère pour ma part que la supériorité musculaire masculine existe (le dimorphisme sexuel est un fait incontestable) mais que cette domination musculaire – qui permet la violence, dont la coercition sexuelle, certes – ne signifie pas pour autant que les femmes soient universellement opprimées par les hommes. Leur importance aux yeux de ces hommes, qui s’entretuent depuis des millénaires pour accéder à leur corps, devrait au contraire les faire réaliser que leur pouvoir est immense. Je n’exclus pas, d’ailleurs, que la rage exponentielle des féministes puisse être à rapporter précisément au fait que les hommes d’aujourd’hui aient de moins en moins envie de s’entretuer pour leurs beaux yeux – mais c’est une autre histoire…
- Sur le même sujet :
Peggy Sastre, « Qui a (toujours) peur de Darwin ? », Le Point, 6/01/20 (article pour abonnés – me demander une copie par mail si besoin)
« Pourquoi les hommes se comportent-ils parfois mal avec les femmes ? », Le Point, 01/07/21
« Chez les chasseurs-cueilleurs, les hommes marchent plus que les femmes », Le Point, 29/03/21